La prévention de la maladie d’Alzheimer
5 mn de lecture
Prévenir Alzheimer est-ce réellement possible ? Oui, dans une certaine mesure, répondent les chercheurs. Selon eux, il serait possible d’éviter 45% des cas de perte d’autonomie liée à des troubles cognitifs d’installation progressive en agissant sur 14 facteurs de risque modifiables.
Alzheimer en chiffres : une réalité mondiale et nationale
Dans le monde : 58 millions de personnes vivaient avec une démence (dont Alzheimer) en 2019, et ce chiffre pourrait atteindre 139 millions en 2050. Chaque 3 secondes, un nouveau cas apparaît.En France : nous comptons 1 million de malades d’Alzheimer et 1,4 millions de personnes pour les malades d’Alzheimer et les maladies dites « apparentées . On compte 225 000 nouveaux cas par an.
Le cerveau commence à vieillir à partir de 30 ans…et le vieillissement s’accélère à partir de 60 ans. Il est donc important d’acquérir de bonnes habitudes le plus tôt possible pour retarder ce phénomène et maintenir son cerveau en bonne santé. Et il n’est jamais trop tard pour s’en préoccuper ! Un cerveau riche de connexions, stimulé, bien oxygéné, sera mieux à même de maintenir ses capacités face aux agressions du vieillissement et des maladies neurodégénératives.
Alzheimer : une maladie qui évolue d’abord silencieusement
La maladie d’Alzheimer se caractérise par trois temps fondamentaux.
- Première phase : des lésions cérébrales spécifiques associées à une période sans aucun trouble intellectuel ni de la mémoire, appelée pour cela « phase asymptomatique ». Cette phase peut durer 15 à 20 ans.
- Deuxième phase : apparition des symptômes (dite phase prodromale).
- Troisième phase : la perte d’autonomie.
Pendant la première phase décrite ci-dessus, les lésions sont présentes, il n’y a pas encore de symptômes, mais le risque de développer la maladie est important, même s’il n’est pas certain. Nous pouvons ainsi faire en sorte de ralentir leur évolution, en permettant au cerveau de compenser mieux et ainsi retarder l’apparition de la phase prodromale, puis la phase de dépendanceIl existe des facteurs de ralentissement de l’expression des lésions cérébrales présentes ou au contraire des facteurs d’accélération. Ce sont les facteurs « modifiables ».
Les 14 facteurs identifiés dans l’étude de Lancet sur lesquels on peut agir
Une étude internationale publiée dans le Lancet en 2024* indique que 45 % des cas de troubles cognitifs du type Alzheimer sont liés à des facteurs de risque sur lesquels on peut intervenir la prévention pourrait jouer un rôle et contribuer, in fine, à réduire le nombre de nouveaux cas dans la population.
Facteurs cognitifs et éducatifs
Un faible niveau d’éducation
« Use it or lose it » – s’en servir ou le perdre : notre cerveau est un capital précieux à faire fructifier tout au long de la vie. Si cela commence dès l’enfance, avec un niveau d’éducation qui influence positivement la réserve cognitive par les différentes formes de stimulation qu’elle engendre, à tout âge on peut développer des connexions et des réseaux neuronaux par des apprentissages et des découvertes.
Facteurs liés au mode de vie et à l’environnement
L’inactivité physique
L’inactivité physique a des conséquences sur la santé : prise de poids, perte de confiance en soi, isolement social, autant de facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer. En revanche, la pratique d’une activité physique régulière stimule la circulation sanguine, y compris dans le cerveau. Des études scientifiques récentes ont montré que l’exercice physique intense (30 minutes par jour) stimule la formation de nouveaux neurones, et ce tout au long de la vie. Si vous ne pouvez faire du sport intensif, la nage, le yoga, la danse, le vélo ou simplement la marche ou le jardinage peuvent permettre de ralentir les problèmes de déclin cognitif. De plus, l’exercice physique stimule la production d’hormones comme les endorphines (qui agissent sur l’humeur), la dopamine (humeur et anti-fatigue) favorisant la régulation du stress et un meilleur sommeil.
L’obésité
On parle d’obésité quand l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30. Elle a pour conséquence le risque de nombreuses complications : diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, articulaires, respiratoires qui peuvent être à l’origine du développement de troubles cognitifs. Il est important d’agir en parallèle sur les apports par une alimentation saine et équilibrée (de type méditerranéen) mais également sur les dépenses par le biais d’activités physiques adaptées.
Les traumatismes crâniens
Tout choc reçu à la tête au niveau du crâne, quelle que soit la violence du choc est un traumatisme crânien. Les situations pouvant engendrer un traumatisme crânien sont nombreuses : chutes, accident de voiture ou de vélo, sports extrêmes ou de contact … Les traumatismes cérébraux répétés, même mineurs, augmentent le risque de troubles cognitifs. Il est donc important de porter des équipements de protection adaptés en vélo, à ski, à cheval ou pour tous les sports de contact : boxe anglaise, rugby, football américain, arts martiaux…
Le tabac
La cigarette est mauvaise pour les poumons, pour le cœur … mais aussi pour le cerveau. En effet, le tabac abîme les vaisseaux sanguins, y compris ceux du cerveau. Les fumeurs ont un risque de développer une maladie d’Alzheimer 40% plus élevé que celui des non-fumeurs. Il est parfois difficile d’arrêter de fumer, n’hésitez pas à en parler autour de vous ou à votre médecin traitant pour obtenir tout le soutien nécessaire. L’arrêt du tabac, même à un âge avancé, réduit ce risque.
La consommation d’alcool
L’alcoolisme nuit au cerveau et en particulier aux circuits de la mémoire. Des études ont montré que la consommation fréquente et excessive d’alcool est liée à une apparition précoce de la maladie d’Alzheimer. Des études récentes soulignent que toute consommation d’alcool, même modérée, a un impact sur le bon fonctionnement cérébral.
La pollution atmosphérique
Si des études complémentaires s’avèrent nécessaires, de récentes études ont montré que la pollution de l’air pouvait engendrer des maladies neurodégénératives. Les particules fines, dioxyde d’azote et le carbone suie (et plus particulièrement liés au trafic routier) accélèrent le déclin cognitif.
Facteurs liés à la santé et la biologie
L’hypertension artérielle
Quand la pression du sang sur les artères est trop élevée, on parle d’hypertension artérielle. Si chacun connait les effets de l’hypertension artérielle sur le cœur, ses conséquences sur le cerveau sont moins connues, mais tout aussi délétères.
L’hypercholestérolémie
Un taux élevé de cholestérol LDL (mauvais cholestérol) favorise la formation de dépôts de protéines β-amyloïdes, qui apparaissent dans le cerveau lors de la maladie d’Alzheimer. Le cholestérol LDL (« mauvais » cholestérol) serait responsable de 7 % des cas de maladie d’Alzheimer dans la population totale.
La perte auditive
Moins bien entendre est un phénomène relativement courant quand on vieillit. Cette perte de l’audition liée à l’âge entraîne des difficultés de compréhension. Ce déficit auditif peut conduire à un isolement social et au développement de troubles cognitifs. Il est donc important, en cas de doute, de faire tester son audition et d’avoir recours si nécessaire à une audio prothèse.
La perte de vision
De même que pour l'audition, des études ont démontré que les personnes âgées présentant des problèmes de vue non corrigés seraient plus susceptibles de développer une maladie neuro-dégénérative comparativement aux autres.
Le diabète
Le diabète correspond à un excès durable de la concentration de glucose dans le sang (hyperglycémie) et apparaît lorsque l’organisme ne produit pas suffisamment d’insuline ou qu’il n’utilise pas efficacement celle qui est produite. Comme le diabète peut se développer silencieusement pendant de nombreuses années et accompagner d’autres facteurs de risque comme l’obésité, il est important de faire vérifier son taux de glycémie par une prise de sang.
Facteurs psychosociaux
La dépression
La dépression est un état dans lequel les gens se sentent tristes, désespérés ou irritables la majeure partie du temps. Ils peuvent également éprouver de l’angoisse et le sentiment d’être isolé. Même si les relations entre dépression et maladie d’Alzheimer doivent être approfondies, il apparaît que les personnes qui ont eu des épisodes dépressifs avant 60 ans présentent un risque plus élevé de développer ultérieurement la maladie. La dépression peut être soignée, parlez-en à un médecin.
L’isolement social
Les liens sociaux stimuleraient le développement d’un réseau neuronal dense qui permettrait de compenser plus longtemps les lésions induites par la maladie d’Alzheimer. En effet des relations sociales stimulantes : passer du bon temps en famille ou entre amis, participer à des clubs, avoir une vie associative… permettent de maintenir le cerveau en bonne santé et de s’entretenir agréablement. Choisissez les activités qui ont du sens pour vous et les personnes avec qui vous vous sentez bien afin de favoriser le plaisir et le rire.
Les 4 piliers de la santé cérébrale
Le rôle protecteur du sommeil
Manquer de sommeil ou souffrir d’apnée du sommeil peut provoquer des problèmes de concentration ou de mémoire. Par ailleurs, c’est durant le sommeil que le cerveau évacue ses déchets, notamment les protéines bêta-amyloïdes.
Il est recommandé de dormir environ 7 heures par nuit et de respecter le cycle veille / sommeil.
Une alimentation saine : un allié contre la démence
Des habitudes alimentaires saines et le maintien d’un indice de masse corporelle (IMC) normal, réduiraient de façon significative les risques de développer la maladie d’Alzheimer.
Un régime équilibré, riche en fruits (dont les fruits rouges) et légumes (dont ceux à feuilles type choux) est recommandé car riches en antioxydants, ils permettent de lutter contre la production de radicaux libres en excès qui sont toxiques pour les neurones.
Le régime méditerranéen, est par exemple reconnu comme particulièrement bénéfique car il permet de consommer des graisses enrichies en oméga-3 (huile d’olive, noix, poisson et fruits de mer) dont le cerveau a besoin pour bien fonctionner, participant ainsi à la réduction du déclin cognitif. La chercheuse Dr Martha Clare Morris du Rush University Medical Center à Chicago a conçu en 2015 un régime pour optimiser la santé cérébrale. Il s’agit du régime MIND pour « Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay » Dietary Approaches to Stop Hypertension qui signifie « Intervention Méditerranéenne-DASH pour ralentir la neurodégénérescence ». Ce régime combine des aspects du régime méditerranéen (préconisé pour réduire les maladies cardiaques) et du régime DASH (préconisé pour réduire l’hypertension) et il se définit à travers la consommation de 10 aliments sains à savourer et de 5 aliments qui doivent être limités.
L’activité physique : un bouclier pour le cerveau
Pratiquer du sport régulièrement entre 45 et 65 ans peut réduire le risque de développer la maladie d’Alzheimer de 40 %. De plus cela augmente l’apport en oxygène et nutriments au cerveau et favorise la santé neuronale. Cela diminue la production des protéines amyloïde et tau, responsables des lésions cérébrales. Il n’est pas forcément obligatoire que cela soit du sport intensif. 30 minutes d’exercice (marche, danse, vélo, jardinage) par jour peuvent suffire pour stimuler la circulation sanguine, favoriser la neurogenèse et améliorer la plasticité cérébrale. Une étude montre que 7 500 pas par jour peuvent retarder le déclin cognitif de 7 ans.
L’activité physique réduit l’accumulation de protéines toxiques (phospho-tau, bêta-amyloïde) et l’inflammation cérébrale, deux marqueurs clés de la maladie.
Les liens sociaux : un rempart pour le déclin cognitif
L’isolement social augmente le risque de démence de 59 %, tandis qu’une vie sociale active réduit ce risque de 12 % et peut retarder l’apparition de la maladie de 5 ans.
Les interactions régulières stimulent des zones clés du cerveau comme l’hippocampe et le cortex préfrontal, favorisent la production de dopamine et réduisent le stress, contribuant ainsi à la résilience cognitive. Elles sollicitent également la mémoire, le langage et la prise de décision, renforçant les circuits neuronaux.
Participer à des activités de groupe, s’engager dans le bénévolat ou rejoindre des clubs constitue donc une stratégie simple et efficace pour préserver ses capacités intellectuelles tout en cultivant le plaisir et le lien social.
Le rôle essentiel des aidants
88 % des malades bénéficient d’un aidant, souvent un membre de la famille (41 % enfants, 27 % conjoint). Les aidants sont majoritairement des femmes (57 %), souvent actives professionnellement. Les aidants jouent un rôle crucial pour maintenir l’autonomie des aidants mais cela peut exposés à un risque élevé de fatigue et de charge mentale.
En conclusion, depuis quelques années, des espoirs concrets sont observables : de nouveaux traitements, des tests de sang innovants et un suivi d’une alimentation méditerranéenne combiné avec de l’exercice correspond à une stratégie de prévention validée scientifiquement. Néanmoins, la prévention d’Alzheimer repose sur une approche globale : agir tôt sur les facteurs de risque, maintenir une vie sociale active, pratiquer une activité physique régulière, soutenir les aidants et miser sur les avancées médicales. Ces leviers combinés peuvent retarder l’apparition des symptômes et améliorer la qualité de vie.
- En savoir plus sur le régime MIND : https://alzheimer-recherche.org/recherche-et-alzheimer/bienfaits-du-regime-alimentaire-mind-sur-la-sante-cerebrale/
- Télécharger le Petit Guide de la santé du Cerveau de la Fondation Recherche Alzheimer ici : https://alzheimerprevention.info/
- Pour aller plus loin, le livre « Alzheimer n’est pas une fatalité » aux Editions HarperCollins : https://www.harpercollins.fr/products/alzheimer-nest-pas-une-fatalite
Article en collaboration avec La fondation Recherche Alzheimer
Nos brochures sur la maladie d'Alzheimer

La maladie d'Alzheimer expliquée aux aidants
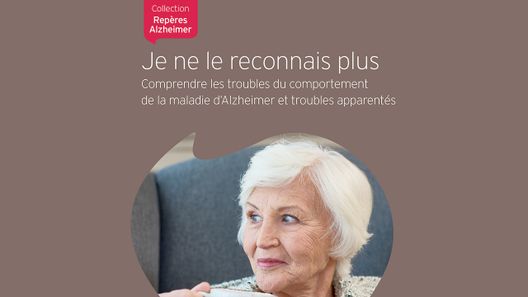
Les troubles du comportement
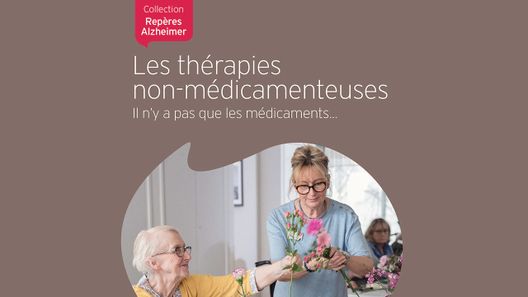
Les thérapies non-médicamenteuses
Vous avez des questions ?
Nous sommes à votre écoute
